Suite à une discussion sur ce blog, ce livre fait l'objet d'une relecture.
Sans revenir sur les idées que j'exprime ici, je peux déjà dire que j'ai fait preuve d'innatention dans ma lecture quant au personnage. Je parlais d'un personnage-narrateur d'origine juive, c'est une erreur. Le livre est à la 3e personne du singulier, le narrateur n'est pas le personnage principal, et ce dernier n'est pas d'origine juive. Il semble plutôt que ce personnage soit une sorte d'avatar de Baubérot lui-même. C'est semble-t-il, un faute d'inattention dans la lecture d'un paragraphe en particulier qui m'a induit en erreur, et je ne l'ai pas corrigé ensuite dans mon esprit.
Ceci étant, ceci reste un détail. Le propos reste le même et on se fiche bien de l'origine des gens.
Cette lecture sous forme de dossier s'ajoute à nos études régulières d'ouvrages anciens, dantant essentiellement des années 60 et 70. Il est en effet intéressant d'observer près de quarante ans plus tard quels sont les points de vues et analyses qui ont marqué une époque, qui se sont conservés ou qui ont disparu. Notre regard se veut ausi très critique des ouvrages abordés.
Jean Baubérot, Le tort d’exister. Des Juifs aux palestiniens, Bordeaux : Editions Ducros, octobre 1970, 262p.
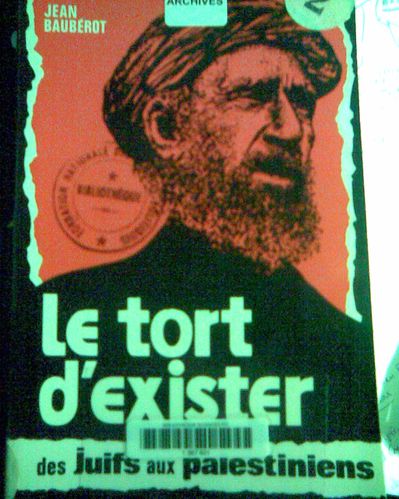
L’originalité de ce livre consiste sûrement en sa forme : mi-roman, mi-plaidoyer politique, il s’agirait d’une forme hybride, une forme de roman politique. Jean Baubérot en effet, y expose un certain nombre d’idées, une certaine vision du monde à travers un personnage. Il y exprime son attirance pour les milieux dits d’extrême gauche, trotskistes et tiers-mondistes, assortie d’une réflexion sur la religion, l’idéologie et l’irréligiosité devenue idéologie et presque nouvelle religion.
 L’auteur en effet, après avoir été étudiant à la Faculté de théologie protestante de Paris, devient un des leaders des jeunes protestants contestataires. En 1965, il devient directeur de la revue Le Semeur puis membre du Comité directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France, dont il démissionne le 2 juin 1967, en désaccord avec le soutien apporté par cette organisation à l’Etat d’Israël. Car le conflit du Proche-Orient lui touche à cœur et c’est à celui-ci qu’il s’attache grandement dans la revue qu’il fonde en mars 1968, Hermès, qui devient ensuite Herytem—critique politique de la vie quotidienne, qui publie un numéro spécial sur le « peuple palestinien » ou les Arabes originaires de la région d’Israël, et sur la « mise en question de l’Occident ».
L’auteur en effet, après avoir été étudiant à la Faculté de théologie protestante de Paris, devient un des leaders des jeunes protestants contestataires. En 1965, il devient directeur de la revue Le Semeur puis membre du Comité directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France, dont il démissionne le 2 juin 1967, en désaccord avec le soutien apporté par cette organisation à l’Etat d’Israël. Car le conflit du Proche-Orient lui touche à cœur et c’est à celui-ci qu’il s’attache grandement dans la revue qu’il fonde en mars 1968, Hermès, qui devient ensuite Herytem—critique politique de la vie quotidienne, qui publie un numéro spécial sur le « peuple palestinien » ou les Arabes originaires de la région d’Israël, et sur la « mise en question de l’Occident ».
Un sujet qui le passionne et qu’il reprend longuement dans cet ouvrage, à travers son personnage. Un personnage dont le parcours est fort ressemblant. Proche des milieux gauchistes, grand lecteur de Marx et de Mao comme les révolutionnaires de son époque, il tente néanmoins de se forger son propre univers, de se démarquer des clichés et caricatures qui limitent tous ces groupuscules. C’est cet univers que nous fait découvrir Jean Baubérot : celui d’un jeune homme d’origine juive qui se cherche et qui cherche à changer le monde dans ce qu’il croit juste : par l’anticolonialisme occidental, l’antisionisme et le pro-palestinisme[1]. Un jeune homme qui voit les Juifs avant Israël comme l’image de l’opprimé pour lequel il faut se battre, une image qu’incarnent aujourd’hui les Arabes en lutte contre Israël, et spécialement l’avant-garde des réfugiés arabes. Un jeune homme marqué par la lutte des classes, par le paupérisme et la lutte contre les riches exploiteurs, par la défense de la classe prolétarienne contre les privilégiés. Mais un jeune homme qui ne colle pas tout à fait avec les analyses marxistes et qui admire un juif religieux antisioniste comme Emmanuel Levyne.
Bref un jeune homme de bonne volonté et révolutionnaire, mais incertain, cherchant à garder son esprit critique sans tomber dans les dérives idéologiques.
Parcours intéressant que celui que nous raconte Baubérot. Imaginaire tout aussi passionnant que celui qu’il nous décrit, même si la forme hybride ne permet pas toujours de se laisser bercer par les considérations philosophiques et intellectuelles de l’auteur comme dans un vrai roman. La forme romancée toutefois, permet à l’auteur de se détacher de la lourdeur stylistique d’une thèse universitaire et académique. Mais l’auteur n’y mène pas moins une tentative de démonstration contre le sionisme et en faveur des mouvements arabistes palestinistes comme l’O.L.P. et le Fatah. C’est donc sur le fond que nos critiques — et c’est naturel — sont les plus vives.
Comme à l’accoutumée, l’essai pêche surtout en ce qu’il porte un jugement négatif sur le sionisme et sur l’histoire occidentale et un jugement favorable sur les mouvements dits du tiers-monde, et les Arabes particulièrement, mais sans jamais remettre en cause ces derniers ou leur histoire. A aucun moment en effet, le narrateur ne réfléchit sur les concepts et le langage utilisés par les groupes palestinistes, alors même qu’il accuse les sionistes de manipuler le langage en leur faveur. Sa réflexion sur le langage est intéressante, mais pourquoi la limiter à un seul camp? A aucun moment non plus, il ne remet en cause l’arabisme, le palestinisme et l’idée qu’il existerait un droit fondamental, inaliénable et préalable, pour les Arabes de vivre (souverainement qui plus est) entre Méditerranée et Jourdain[2]. A aucun moment donc, il ne remet en cause l’idéologie et la lecture palestiniste. En cela il s’ancre pleinement dans la dominante intellectuelle des années 1970, contrairement à l’idée que se font les révolutionnaires gauchistes d’être, en ce domaine comme dans d’autres, marginaux.
Le narrateur et par lui l’auteur, critique encore le fait par exemple, qu’en voulant être « comme les autres », les sionistes ont reproduit un mode de vie occidental, et aujourd’hui l’American way of life que le narrateur rejette, non seulement comme exploiteur et oppresseur, mais aussi comme banalisant. Un mode de vie occidental, moderniste — et non seulement moderne — qu’il juge impérialiste (sans jamais qu’on sache réellement pourquoi), injuste, colonisateur, oppresseur.
Et au-delà de ces schèmes mentaux qu’on a déjà analysés ailleurs, la démonstration de Baubérot souffre souvent de défauts de logique, passant d’un énoncé à un autre sans que la conséquence en soit réellement justifiée. Ceci découle souvent du fait qu’il perçoit tout discours réellement critique sur l’action des groupes arabes comme la perception sioniste, sans jamais se demander si celle-ci n’a pas sa raison d’être ou si elle n’est pas tout simplement juste. Bref il souffre surtout d’une incapacité à remettre en cause l’énoncé arabe, qui s’explique et se justifie en tout point selon lui. L’oppression en étant la justification. Il cherche souvent par exemple à établir une relation conjointe entre le traitement des Juifs au cours du Moyen-âge en Europe, et celui des Arabes d’Israël ou originaires d’Israël à notre époque. Pourtant, à aucun moment, il ne part d’une analyse concrète et pragmatique des faits, à aucun moment il ne réfléchit sur les fondements de la lutte arabe, et à aucun moment il ne cherche à comparer avec la situation des Juifs en pays arabes, aujourd’hui comme hier. Sans prétendre que la situation des Arabes en Israël est idyllique, il ne cherche ni à regarder réellement les difficultés posées par une population hostile en Israël même, ni à contester les fondements de cette hostilité. C’est point par point qu’il faudrait démonter une telle argumentation devenue aujourd’hui trop commune et que les événements — on s’en rend bien compte aujourd’hui — infirment tous les jours (affirmation ô combien scandaleuse, il suffit d’énoncer quelques vérités : il n’y a pas de ghetto arabe en Israël, les Arabes citoyens ont les mêmes droits que les autres, il n’y a pas d’impôt arabe, pas de pogroms, j’en passe). Avec une telle comparaison, le propos de l’auteur touche à l’outrance et n’a plus de fondement de scientifique, ça n’a rien de sérieux, c’est pitoyable.
Baubérot est même pris, dans sa diatribe anticolonialiste occidentale, en flagrant délit de soutien au colonialisme arabe. Evoquant l’histoire française à l’époque de Charles Martel, il prétend que la victoire remportée par ce dernier sur les Arabes à Poitiers devrait faire figure de recul pour l’humanité, qui aurait profitée d’une domination arabe, comme en Espagne. Voilà donc un homme qui condamne le paternalisme occidental, mais qui en vient à souhaiter la même forme de prétention pour les Arabes. Un argument non seulement particulièrement vicieux, mais par ailleurs subjectif et faux historiquement. D’une part parce que l’époque de Charlemagne a constitué ce que les historiens du Moyen-âge appellent aujourd’hui la « renaissance carolingienne », d’autre part parce qu’elle souffre d’une vision imagée et idyllique d’un âge d’or musulman espagnol qui fait abstraction des rapports de force concrets entre populations musulmanes, chrétiennes et juives, et des périodes intégristes musulmanes — particulièrement des Almohades.
Baubérot en clair, malgré tout un ensemble de réflexions intéressantes et originales, n’en échappe pas moins à l’admiration acritique des Arabes et du tiers-monde dont a souffert son époque.
Sa biliographie en témoigne. Si elle est riche, diverse et variée, de S.W. Baron à François Lovsky, il n’en reste pas moins qu’on perçoit la mobilisation régulière de thèses comme de faits avancés par les plus grands antisionistes comme Maxime Rodinson en France (qui a collaboré à la revue Herytem de Baubérot) et Nathan Weinstock en Israël (un Weinstock qui en 2005 revenait d’ailleurs sur ses livres antérieurs). La conception de la civilisation occidentale judéo-chrétienne du narrateur l’amène aussi à penser comme cet autre auteur marxiste antisioniste et d’origine juive Isaac Deutscher, que cette civilisation contient en germes les mauvais fondements qui l’ont amené au nazisme.
Il serait temps de comprendre que si cette civilisation a été capable du pire, premièrement elle n’en est pas la seule (elle a simplement été la seule à être capable de mener ce pire, technologiquement), deuxièmement elle est aussi celle qui a été capable du meilleur.
[1] Voir pour ce terme Misha Uzan, « Israël et les intellectuels français, 1967-1982 » in Controverses. Revue d’idées, n°7, février 2008
[2] Voir sur ce point mes remarques dès le début de mon mémoire : Misha Uzan, Images d’Israël et compréhension du conflit israélo-arabe par les intellectuels français, de 1967 à 1982, sous la direction de Jean-François Sirinelli, IEP Paris : 2007.
Repris in Misha Uzan, « Israël et les intellectuels français, 1967-1982 » in Controverses. Revue d’idées, n°7, février 2008

 J’ai donc vu dans La Soirée d’Elseneur ce même goût pour la piété, la campagne, le calme. J’y ai retrouvé ce penchant de Blixen pour l’histoire de deux sœurs pieuses. Sauf qu’ici elle glisse un peu vers le fantastique. Un spectre apparaît, c’est celui de leur frère, mort loin de là et avec qui elles avaient tout partagé. L’originalité de l’histoire, déjà à l’époque, c’est l’attrait que provoque le spectre de leur frère, mais de peur point. Ni roman noir, ni d’épouvante, c’est un conte fantastique et simple. L’épouvante, ce n’est que celle ressentie par les sœurs en apprenant que leur frère, déjà mort, doit à nouveau repartir en tant que spectre, pour l’enfer, car elles voudraient le suivre. C’est une histoire de famille, d’amour fraternel, de partage. Dans Le Festin de Babette, c’est Babette la cuisinière qui porte le message avec son festin comme expression artistique, comme soustraction de « l’alimentation à l’emprise de la nécessité »[1] ; dans La Soirée d’Elseneur c’est le frère qui prend à revers la vie pieuse de ses sœurs de par ses voyages, ses nombreuses femmes, sa piraterie, sa mort … pendu. Le message de Karen Blixen est sûrement à chercher par là, dans cette autre opposition entre des êtres si proches, que leur condition sexuelle place dans des situation ô combien différentes.
J’ai donc vu dans La Soirée d’Elseneur ce même goût pour la piété, la campagne, le calme. J’y ai retrouvé ce penchant de Blixen pour l’histoire de deux sœurs pieuses. Sauf qu’ici elle glisse un peu vers le fantastique. Un spectre apparaît, c’est celui de leur frère, mort loin de là et avec qui elles avaient tout partagé. L’originalité de l’histoire, déjà à l’époque, c’est l’attrait que provoque le spectre de leur frère, mais de peur point. Ni roman noir, ni d’épouvante, c’est un conte fantastique et simple. L’épouvante, ce n’est que celle ressentie par les sœurs en apprenant que leur frère, déjà mort, doit à nouveau repartir en tant que spectre, pour l’enfer, car elles voudraient le suivre. C’est une histoire de famille, d’amour fraternel, de partage. Dans Le Festin de Babette, c’est Babette la cuisinière qui porte le message avec son festin comme expression artistique, comme soustraction de « l’alimentation à l’emprise de la nécessité »[1] ; dans La Soirée d’Elseneur c’est le frère qui prend à revers la vie pieuse de ses sœurs de par ses voyages, ses nombreuses femmes, sa piraterie, sa mort … pendu. Le message de Karen Blixen est sûrement à chercher par là, dans cette autre opposition entre des êtres si proches, que leur condition sexuelle place dans des situation ô combien différentes. 



 Et puis il y a tous ces contes et ces légendes vietnamiennes qu’elle nous livre au passage tout en aérant son texte. Je ne connaissais rien à la mythologie vietnamienne, elle m’a rappelé la grecque et une once de légendes bretonnes, de très belles légendes. J’ajouterais simplement que leur fin est parfois un peu triste, un peu inachevée, laissant les héros sombrer en pierres ou en statues dans la plupart des cas. Mais on ne change pas des légendes. Et puis elles sont bien racontées. Surtout lorsque Minh Tran Huy les disperse tout le long, comme l’histoire de ce frère et de sa sœur que les astres ont condamnés à s’épouser. Le conte est réparti en quatorze points, qu’on lit chacun à la fin d’un chapitre. J’ai bêtement mis longtemps à comprendre que ce petit texte séparant chaque chapitre était la suite du précédent. Le jeu littéraire m’a amusé et je ne n’ai pas résisté, une fois le principe compris, à sauter des pages pour lire directement la fin du conte. Son écriture enfin est limpide et propre. Simple dans le style d’un récit, d’une nouvelle, elle prend néanmoins une tournure plus littéraire, plus ondulée dirais-je, plus fracassante dans les dernières pages sur son ami Nam. Il en fallait un peu pour finir, tel un bouquet final.
Et puis il y a tous ces contes et ces légendes vietnamiennes qu’elle nous livre au passage tout en aérant son texte. Je ne connaissais rien à la mythologie vietnamienne, elle m’a rappelé la grecque et une once de légendes bretonnes, de très belles légendes. J’ajouterais simplement que leur fin est parfois un peu triste, un peu inachevée, laissant les héros sombrer en pierres ou en statues dans la plupart des cas. Mais on ne change pas des légendes. Et puis elles sont bien racontées. Surtout lorsque Minh Tran Huy les disperse tout le long, comme l’histoire de ce frère et de sa sœur que les astres ont condamnés à s’épouser. Le conte est réparti en quatorze points, qu’on lit chacun à la fin d’un chapitre. J’ai bêtement mis longtemps à comprendre que ce petit texte séparant chaque chapitre était la suite du précédent. Le jeu littéraire m’a amusé et je ne n’ai pas résisté, une fois le principe compris, à sauter des pages pour lire directement la fin du conte. Son écriture enfin est limpide et propre. Simple dans le style d’un récit, d’une nouvelle, elle prend néanmoins une tournure plus littéraire, plus ondulée dirais-je, plus fracassante dans les dernières pages sur son ami Nam. Il en fallait un peu pour finir, tel un bouquet final. 
 Ce livre est une énigme. Un message à caractère non identifié. Un poème d’amour, de vie, d’ennui en 124 pages. Ni kafkaïen ni existentialiste, surréaliste. Avec son quatrième roman Laurent Graff confirme son caractère singulier. Déroutant, troublant, désopilant, grave et malgré tout captivant. Un livre à méditer peut-être, sinon à délaisser. On ne saurait plus le déchiffrer.
Ce livre est une énigme. Un message à caractère non identifié. Un poème d’amour, de vie, d’ennui en 124 pages. Ni kafkaïen ni existentialiste, surréaliste. Avec son quatrième roman Laurent Graff confirme son caractère singulier. Déroutant, troublant, désopilant, grave et malgré tout captivant. Un livre à méditer peut-être, sinon à délaisser. On ne saurait plus le déchiffrer. 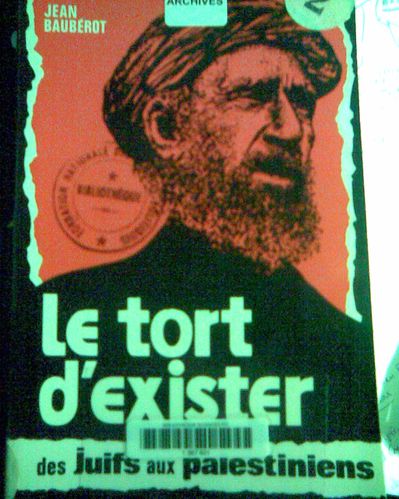
 L’auteur en effet, après avoir été étudiant à la Faculté de théologie protestante de Paris, devient un des leaders des jeunes protestants contestataires. En 1965, il devient directeur de la revue Le Semeur puis membre du Comité directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France, dont il démissionne le 2 juin 1967, en désaccord avec le soutien apporté par cette organisation à l’Etat d’Israël. Car le conflit du Proche-Orient lui touche à cœur et c’est à celui-ci qu’il s’attache grandement dans la revue qu’il fonde en mars 1968, Hermès, qui devient ensuite Herytem—critique politique de la vie quotidienne, qui publie un numéro spécial sur le « peuple palestinien » ou les Arabes originaires de la région d’Israël, et sur la « mise en question de l’Occident ».
L’auteur en effet, après avoir été étudiant à la Faculté de théologie protestante de Paris, devient un des leaders des jeunes protestants contestataires. En 1965, il devient directeur de la revue Le Semeur puis membre du Comité directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France, dont il démissionne le 2 juin 1967, en désaccord avec le soutien apporté par cette organisation à l’Etat d’Israël. Car le conflit du Proche-Orient lui touche à cœur et c’est à celui-ci qu’il s’attache grandement dans la revue qu’il fonde en mars 1968, Hermès, qui devient ensuite Herytem—critique politique de la vie quotidienne, qui publie un numéro spécial sur le « peuple palestinien » ou les Arabes originaires de la région d’Israël, et sur la « mise en question de l’Occident ». 
 Dès les premières pages du livre on a envie d’en connaître le dénouement. Les péripéties de Nathalie Hertz et ses amourettes ont presque quelque chose de rébarbatif, bien que tout à fait agréable en réalité, comparé au miracle des yeux de la Vierge. On voudrait connaître le résultat de l’expertise qui a de quoi passionner. Sachez en tout cas que Jean Paul II a canonisé Juan Diego en 2002, malgré les contestations et malgré les rebondissements de la fin du roman … inspiré de la réalité. Alors que croire ?
Dès les premières pages du livre on a envie d’en connaître le dénouement. Les péripéties de Nathalie Hertz et ses amourettes ont presque quelque chose de rébarbatif, bien que tout à fait agréable en réalité, comparé au miracle des yeux de la Vierge. On voudrait connaître le résultat de l’expertise qui a de quoi passionner. Sachez en tout cas que Jean Paul II a canonisé Juan Diego en 2002, malgré les contestations et malgré les rebondissements de la fin du roman … inspiré de la réalité. Alors que croire ? 
 il bavarde et noie sa solitude, mais qu’il est le seul à voir. Christian Bobin était parait-il solitaire et rêveur dans sa jeunesse, tel est aussi son personnage. Ce dernier vit dans son propre monde, son violon à la main, plein d’amour pour les autres et pour Geai, à ses côtés. Albain vit en dehors du monde qu’il ne comprend pas et ne veut pas réellement comprendre. Il vit du sourire de Geai, de la beauté des meubles, des animaux et parfois de certaines femmes qu’il observe, rencontre et qui prennent la place symbolique de Geai. Albain n’est sûrement pas un génie nous dit Bobin, on ne sait pas vraiment non plus si c’est un idiot ajoute-t-il.
il bavarde et noie sa solitude, mais qu’il est le seul à voir. Christian Bobin était parait-il solitaire et rêveur dans sa jeunesse, tel est aussi son personnage. Ce dernier vit dans son propre monde, son violon à la main, plein d’amour pour les autres et pour Geai, à ses côtés. Albain vit en dehors du monde qu’il ne comprend pas et ne veut pas réellement comprendre. Il vit du sourire de Geai, de la beauté des meubles, des animaux et parfois de certaines femmes qu’il observe, rencontre et qui prennent la place symbolique de Geai. Albain n’est sûrement pas un génie nous dit Bobin, on ne sait pas vraiment non plus si c’est un idiot ajoute-t-il. 
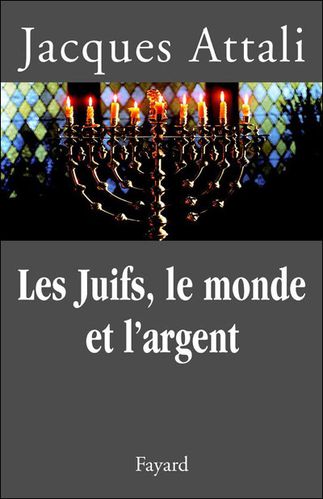
 Auteur de nombreux romans politiques et historiques, Gilles Perrault est un habitué des romans de guerre et un connaisseur de la seconde guerre mondiale, sur laquelle il a mené quelques recherches. Il saisit un moment d’histoire dans Le Garçon aux yeux gris et une question politique dans Le Soldat perdu. J’ai naïvement cru que cette seconde histoire était une suite de la première qui ne se finit pas vraiment. Elle fut en réalité publiée un an plus tôt et le décor est tout autre. Il ne s’agit plus de la guerre de 40 mais de la lutte d’Irlande du Nord contre l’Angleterre, à la fin de l’ère Thatcher. Le narrateur parle cette fois à la première personne et n’est autre qu’un français travaillant pour l’IRA. Sous couvert d’un personnage c’est probablement Perrault qui parle derrière lui. Il défend la lutte antibritannique en Ulster et ne renie pas le vocable de « terroriste » s’il le faut, mais pour une bonne cause, dit-il. L’environnement est assez trouble au milieu des histoires d’espionnage, de Maureen, celle qu’il aime et de Gérard son meilleur ami. Petite histoire de moins de 50 pages c’est en fait trop court pour en faire un véritable polar. C’est peut-être plus le message qu’il faut entendre : celui de l’IRA contre l’Angleterre. Les réflexions sur la domination anglaise ne sont pas dépourvues d’intérêt mais elles mériteraient néanmoins élargissement et plus grande réflexion.
Auteur de nombreux romans politiques et historiques, Gilles Perrault est un habitué des romans de guerre et un connaisseur de la seconde guerre mondiale, sur laquelle il a mené quelques recherches. Il saisit un moment d’histoire dans Le Garçon aux yeux gris et une question politique dans Le Soldat perdu. J’ai naïvement cru que cette seconde histoire était une suite de la première qui ne se finit pas vraiment. Elle fut en réalité publiée un an plus tôt et le décor est tout autre. Il ne s’agit plus de la guerre de 40 mais de la lutte d’Irlande du Nord contre l’Angleterre, à la fin de l’ère Thatcher. Le narrateur parle cette fois à la première personne et n’est autre qu’un français travaillant pour l’IRA. Sous couvert d’un personnage c’est probablement Perrault qui parle derrière lui. Il défend la lutte antibritannique en Ulster et ne renie pas le vocable de « terroriste » s’il le faut, mais pour une bonne cause, dit-il. L’environnement est assez trouble au milieu des histoires d’espionnage, de Maureen, celle qu’il aime et de Gérard son meilleur ami. Petite histoire de moins de 50 pages c’est en fait trop court pour en faire un véritable polar. C’est peut-être plus le message qu’il faut entendre : celui de l’IRA contre l’Angleterre. Les réflexions sur la domination anglaise ne sont pas dépourvues d’intérêt mais elles mériteraient néanmoins élargissement et plus grande réflexion. 
